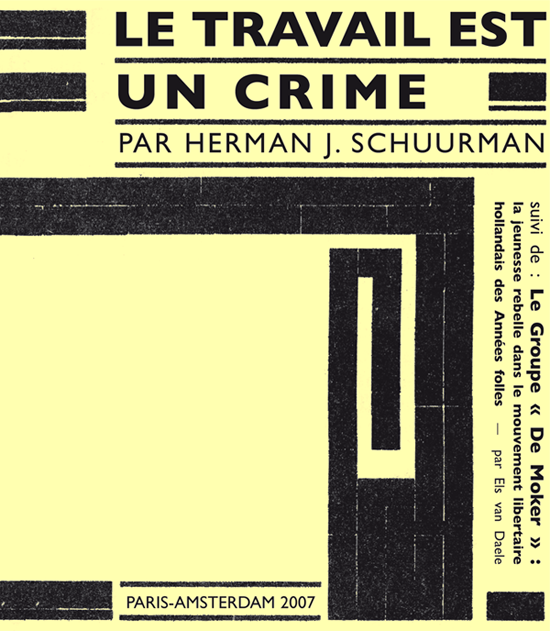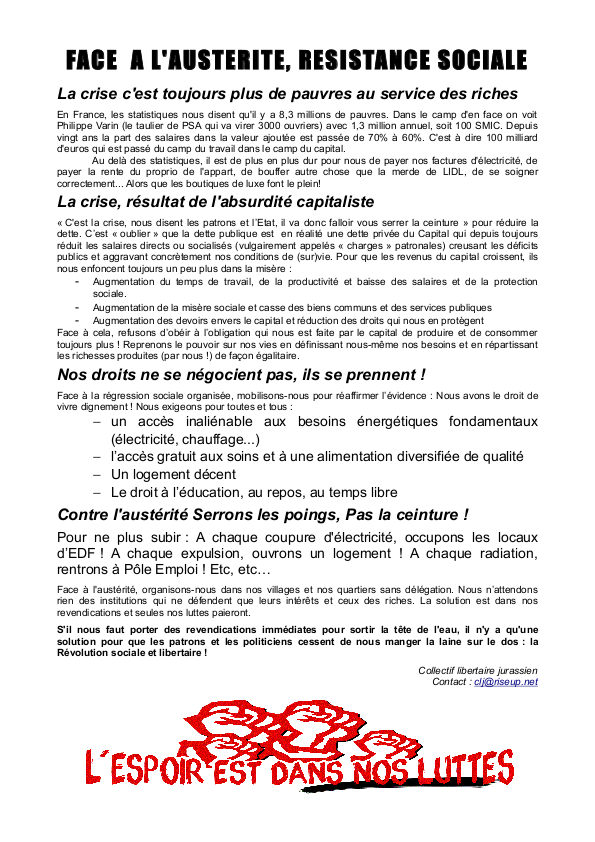Recherche
-
Billets récents
- [Metz] Amnistie totale du mouvement social !
- [In memoriam] « Fracture », revue autogestionnaire dans la santé
- Contre le démantèlement de la convention collective de la Croix Rouge, grève le 16 mai au Centre Médico-Chirurgical des Massues (Lyon)
- [Éducation] Opposons-nous à la part modulable dans les réseaux Éclair
- [Mort aux El-Assad et à tous leurs complices !] Une guerre contre tous les régimes du monde
- « Le Combat Syndicaliste » n°379, mai 2013
- [Franche-Comté] 1er Mai libertaire à Besançon
- [1er Mai] Les manifestations dans le Jura
- [Lyon] 1er Mai : Nos luttes, notre changement !
- Le 1er Mai 2013 à Saint-Pons-de-Thomières
Commentaires récents
- l'alternactiste dans [In memoriam] « Fracture », revue autogestionnaire dans la santé
Archives
Rubriques
- Alimentation (1)
- Autodéfense (1)
- Chômeurs & Précaires (1)
- Confédéral (2)
- Éducation (2)
- Franche-Comté (1)
- General (1)
- Histoire (1)
- Interlibertaire (1)
- International (1)
- Jura (2)
- Rendez-vous (6)
- Santé-Social & Collectivités territoriales (3)
- Table de presse (6)
- Terre & Environnement (2)
Méta
[1er Mai] L’austérité pour les intérêts des États et des patrons, pas pour ceux des travailleurs !
Publié dans Confédéral
Marqué avec 1er Mai
Commentaires fermés sur [1er Mai] L’austérité pour les intérêts des États et des patrons, pas pour ceux des travailleurs !
« La Griffe du Social » n°24, mai 2013
Publié dans Santé-Social & Collectivités territoriales, Table de presse
Marqué avec La Griffe du Social, Région parisienne
Commentaires fermés sur « La Griffe du Social » n°24, mai 2013
[Chômeurs & Précaires] L’humanité qui convient
« Aujourd’hui, c’est le grand jour pour moi car je vais me brûler à Pôle Emploi. »
Djamal Chaar, Nantes, février 2013.
Djamal Chaar est mort. Il s’est immolé par le feu mercredi 13 février 2013 face à un Pôle Emploi, à Nantes. Deux jours après, un autre chômeur tentait de se donner publiquement la mort à Saint-Ouen, et un autre encore quelques jours plus tard dans un Pôle Emploi de Bois-Colombes. Déjà, l’été précédent, un homme était mort après s’être immolé à la CAF de Mantes-la-Jolie. À l’époque, la ministre des affaires sociales et de la santé, avait « fait part de sa profonde émotion face à cet acte désespéré d’une personne que les difficultés de la vie ont manifestement conduit à un geste tragique». La ministre déléguée chargée de la lutte contre l’exclusion avait ajouté qu’« en première ligne face à ces difficultés sociales, le personnel de la CAF a rempli sa mission avec sérieux et compétence ».
Au lendemain de la mort de Djamal Chaar, le président de la République évoquera avant tout le caractère « exemplaire » du « service public de l’emploi ». Les réactions publiques, comme à chaque fois, qualifient le geste de « drame personnel », on exprime à peu de frais son émotion tout en cherchant à déresponsabiliser l’institution. Une cellule psychologique est créée pour les agents, le sale boulot de gestion de la précarité peut reprendre. Et si quelques voix s’élèvent pour faire du mort une victime, ces discours participent d’un consensus qui recouvre la dimension politique de ce qui a eu lieu.
La veille de son immolation, Djamal Chaar écrit : « J’ai travaillé 720h et la loi, c’est 610h. Et Pôle Emploi a refusé mon dossier ». Le ministre du travail et du dialogue social répondra : « Les règles ont été appliquées avec l’humanité qui convient, avec les explications nécessaires, mais il y a parfois des moments où on est dans une telle situation, qu’on ne comprend plus les explications ».
L’humanité qui convient. Quiconque a affaire à Pôle Emploi ou à la CAF sait ce dont il s’agit. C’est l’État qui remet à un agent le soin de décider des moyens de subsistance d’un autre humain. Ce sont des calculs comptables qui font oublier les vies derrière les chiffres. Ce sont des règles d’indemnisation opaques, arbitraires, rarement explicitées et qui excluent plus de la moitié des chômeurs de l’allocation. C’est le mépris et le soupçon avec lesquels on traite quiconque dépend d’une institution pour ses revenus. C’est transformer les droits sociaux en dettes individuelles et réduire par là tout horizon, toute capacité à se projeter.
L’humanité qui convient, c’est nous culpabiliser de n’avoir pas d’emploi dans cette société-là et nous forcer à jouer le jeu. C’est une logique qui transpire partout. Elle s’impose aussi à nous dans l’entreprise où chacun est contraint à grands coups de management de s’impliquer personnellement, de se réaliser en tant que capital humain, de faire corps avec son travail aussi indésirable soit-il.
Djamal Chaar a décidé de ne pas faire le grand saut dans le noir en silence. Nous ne pouvons accepter comme un « accident de parcours » l’acte d’un homme qui a décidé de mourir en accusant. S’obliger à parler. Dire que l’institution tue. Dire qu’il ne s’agit pas de « drames personnels ». Et si son geste nous renvoie à nous-mêmes, à nos solitudes et nos découragements, il nous renvoie aussi à la nécessité de s’attaquer à cette violence qui nous est faite. Dans l’entraide et la solidarité, que nous éprouvons par bribes au présent et que nous essayons de construire jour après jour, nous voyons un des moyens pour reprendre, ensemble, prise sur nos vies.
Des collectifs de chômeurs et précaires réunis en coordination : CAFCA Ariège, CCPL Lille, Exploités-Énervés Cévennes, CAFards de Montreuil, La C.R.I.S.E à Nancy, Permanence Précarité CIP-IDF, CNT-UL Chelles & Marne-la-Vallée, Réseau Stop Précarité, Recours-Radiations – avril 2013
Publié dans Chômeurs & Précaires
Commentaires fermés sur [Chômeurs & Précaires] L’humanité qui convient
[« N’Autre école » n°34/35, avril 2013] « École – Entreprise : ça travaille ! »
Apprendre, entreprendre : de quoi parle-t-on ?
Est-ce que l’Entreprise n’est que ce que le Capital nous dicte : la liberté d’entreprendre pour tous, mais les profits et les plus-values pour quelques-uns ? Ou pouvons-nous prendre la liberté d’entreprendre nos vies ?
Et, en attendant : quels sont les liens entre l’école et l’entreprise ? Est-ce que l’école est en passe de devenir une entreprise comme les autres ? Est-ce qu’on y dresse les futurs salariés ?
Bref, est-ce que le travail nous tient sous son emprise dès l’école, ou avons-nous prise sur le travail (scolaire), et pouvons-nous le transformer pour le réintégrer à nos vies ? Aux jeunes lecteurs, de 7 à 77 ans de trouver leurs réponses dans le dossier inédit sur le traitement du monde du travail dans les livres jeunesses. Aux vieux lecteurs, de 7 à 77 ans, de trouver leurs réponses chez Nordmann, Levaray, Collot…
N’Autre école, avril 2013, numéro double 34-35, 64 pages
Pour commander le numéro, version papier (6€) ou électronique (2€) ou pour s’abonner
Publié dans Éducation, Table de presse
Marqué avec N'Autre école
Commentaires fermés sur [« N’Autre école » n°34/35, avril 2013] « École – Entreprise : ça travaille ! »
Le travail est un crime
Publié dans Table de presse
Marqué avec Éditions Antisociales
Commentaires fermés sur Le travail est un crime
[Interlibertaire] Campagne jurassienne de résistance à l’austérité
Cher-e-s camarades,
Nous sommes heureux de vous annoncer la constitution d’un “collectif libertaire jurassien” regroupant des militant-e-s de divers horizons. Ce collectif pluraliste en construction se donne pour objectif pour le moment de porter une campagne anarchiste contre l’austérité dans le but de renforcer et initier des luttes offensives contre la dégradation de nos conditions de vie ; Nous voulons aussi peser dans le débat des idées et porter qu’il ne se trouve aucune solution pour les opprimé-e-s dans l’économie capitaliste et l’organisation étatiste, que seule la révolution sociale et libertaire mettra fin à nos misères.
Vous trouvez ci-joint le matériel que nous avons actuellement produit pour notre campagne de résistance à l’austérité.
Nous serons heureux de partager notre matériel, expérience avec les camarades qui souhaitent une action spécifique contre l’austérité.
Nous espérons vous retrouver rapidement dans des luttes massives, radicales et surtout victorieuses.
Salutations anarchistes,
Le Collectif libertaire jurassien – janvier 2013
Publié dans Interlibertaire, Jura
Marqué avec Collectif libertaire jurassien
Commentaires fermés sur [Interlibertaire] Campagne jurassienne de résistance à l’austérité
« Le vent se lève » n°13, novembre 2012
Publié dans Table de presse, Terre & Environnement
Marqué avec Le vent se lève
Commentaires fermés sur « Le vent se lève » n°13, novembre 2012
[Terre et liberté] Entretien : l’expérience de ferme autogérée du Sabot (ZAD)

Le Combat Syndicaliste : Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Micka : Moi, c’est Micka, je ne suis pas originaire du coin. Avant je travaillais en maraîchage et j’étais militant à côté. Je suis venu là pour allier les deux, mêler l’agriculture à la lutte.
Clément : Moi c’est Clément, je ne suis pas du coin non plus. J’étais en Mayenne avant de venir sur la ZAD. Je travaillais dans des assos naturalistes, plus dans l’écologie. Ça faisait un petit bout de temps que j’avais des projets agricoles car je pense que l’agriculture est super importante pour les luttes contre ce système, c’est un point de base en fait. C’est comme ça que je suis venu m’installer sur la ZAD.
Pouvez-vous nous présenter Reclaim the Fields, son historique et sa problématique ?
Micka : C’est un mouvement. Ni une association, ni un collectif, nous employons plutôt le terme de « constellation », ça rassemble des groupes ou individus à droite-à gauche, qui se ressemblent autour d’idées à peu près communes. Il y a l’idée d’accès à la terre, d’autonomie alimentaire… C’est né au départ comme la section jeunes de la Via campesina [Organisation internationale regroupant des petits et moyens paysans militant notamment pour le droit à la souveraineté alimentaire] puis ça s’est vite émancipé et il y a eu une première rencontre européenne en octobre 2009 à Minerve (Hérault) [À l’occasion d’un camp international à la ferme, coopérative et SCOP La Cravirola], qui a posé les bases du mouvement. Dans chaque pays il y a des groupes qui font vivre ce réseau et en France, RTF est un des groupes les plus actifs.
Clément : Donc une problématique de luttes paysannes, à la base c’est venu des jeunes de la Via campesina qui se sont rendus compte qu’il y a beaucoup de jeunes paysans ou qui veulent le devenir qui ne sont pas syndiqués et qui ont un peu envie de sortir du syndicalisme. RTF est venu de ça aussi à la base. Les dernières rencontres européennes ont eu lieu sur la ZAD début septembre.
Micka : Tout ça est bien expliqué dans le bulletin de Reclaim the Fields, notamment dans le premier numéro.
Votre engagement contre l’aéroport a-t-il commencé avec votre installation au Sabot ou étiez vous impliqué auparavant ?
Micka : Il a commencé en même temps, on ne connaissait que vaguement l’histoire de l’aéroport. On est venus pour cette occupation de terres contre l’aéroport et son monde.
Clément : Avant la création du Sabot il y a déjà eu une rencontre entre gens de RTF et gens de la ZAD qui étaient venus à une rencontre francophone à Dijon qui a fait qu’en février 2011 il y a eu une réunion sur la ZAD où il a été discuté les apports que RTF pouvait faire à la ZAD. C’est là qu’on a découvert ce qui se passait ici, la lutte contre l’aéroport et en particulier les occupations.

Pouvez-vous nous raconter comment s’est passé la création du Sabot, la manif de défrichage et l’installation du lieu ?
Micka : La manif du 7 mai 2011. On avait donné rendez-vous aux gens à la Paquelais, un village proche du terrain qu’on visait. L’idée était de faire une manif fourches en main, du même type qu’il avait eu à Dijon pour ouvrir le potager des Lentillères à côté des Tanneries. Ils étaient venus défricher collectivement, l’idée avait bien marché, c’était assez cool de venir nombreux pour faire une action illégale et de faire venir des familles et des gens comme ça, dans la bonne humeur et sans stress. L’idée était de le refaire ici, à plus nombreux. À la Paquelais, plein de gens étaient outillés de croissants, de faux, de faucilles, de débroussailleuses, de pleins d’outils différents… j’ai vu quelqu’un avec une hallebarde ! C’était assez bon enfant, il n’y avait pas un flic à l’horizon. On a marché sur le Sabot au son de la batucada. On s’est arrêté devant la parcelle, il y a eu un discours assez chouette et tout le monde est entré dans la parcelle pour défricher pendant que le bar était en train de s’installer, que les cuisines se montaient. En quelques heures, on s’est rendu compte de l’efficacité de 1000 personnes : il y avait 70 ares à défricher, une friche de 20 ans. Les gens alternaient défrichage et incursions à la buvette. Il y a eu des prises de parole en même temps de gens impliqués dans diverses luttes similaires ailleurs comme No-TAV ou Khimki en Russie. Concert le soir, fête. Les jours qui ont suivi on a continué, le défrichage était fini, on a abattu les arbres qui étaient sur le terrain. On a désouché et commencé à mettre en culture dans la dizaine de jours qui a suivi le 7 mai. Au départ, les bâtiments étaient assez sommaires, c’était un terrain nu, des gens avaient un poids lourd aménagé, ça a un peu sauvé au début. Sinon, on a vécu dans une grande tente. Au fur et à mesure on a acquis un mobil home, on a aménagé une cabane autour. Un petit tunnel pour stocker du matos a été récupéré sur un squat sur la zone. Ça a pris quelques mois pour bien s’installer, trouver des panneaux solaires pour avoir un peu de jus, faire un forage pour avoir de l’eau potable et d’irrigation. On avait fait un planning de cultures à l’avance et des plants avaient été préparés au préalable, des gens nous en ont donné à droite-à gauche pour arriver prêts en mai, ce qui était un peu tard dans la saison. Entre la décision de faire le Sabot en février et le mois de mai, on s’était un minimum organisé pour que les cultures puissent commencer rapidement.
Quel était le fonctionnement collectif du Sabot ?
Micka : C’était un collectif de 6-8 personnes, pas un collectif mouvant comme dans d’autres squats. Le fonctionnement était horizontal, on travaillait au mieux tous ensemble sachant que des gens avaient plus de capacités en bricolage, d’autres en maraîchage. On partageait les connaissances au mieux. Ça a plutôt pas mal marché, malgré des hauts et des bas. Comme ça n’était pas évident de vivre sur la ZAD au quotidien, on avait fait une sorte de roulement. Sur les huit, il y en avait quatre sur place. C’était ce collectif-là qui gérait le lieu pour la première année. On s’était engagés à faire la saison. On ne savait pas au départ dans quoi on se lançait. On ne connaissait ni la ZAD, ni la région. On quittait nos tafs, nos études, on avait d’autres activités ailleurs. On s’était dit « on verra bien, on fera une saison et on verra comment ça se passe ». Au bout de la première année, le collectif s’est un peu étiolé et pour la deuxième année les gens étaient un peu différents.
Clément : La deuxième année il y avait un peu moins de monde au départ, les gens qui sont venus souhaitaient pour la plupart un fonctionnement un peu plus collectif. Le Sabot s’est un peu plus transformé en jardin collectif, avec une équipe à peu près stable avec entre cinq et huit personnes qui se retrouvaient une fois par semaine pour prendre des décisions et des gens de passage ou d’autres squats de la ZAD qui venaient pour filer des coups de main.
Quelle était votre production, en terme de quantités, de consommateurs, etc. ?
Micka : Il y avait un hectare de maraîchage diversifié. On estime que ça bénéficiait à une centaine de personnes. On vendait sur place à prix libre pour les autres squatteurs et pour les gens des alentours, les gens des bourgs, les voisins, tout le monde pouvait venir sur place. On a essayé de fournir en légumes des cantines pour des événements type manifs ou week-ends d’action, de réunions sur la ZAD. On a fourni pour le camp de Valogne, à Angers pour un squat de demandeurs d’asile, il y aurait eu des grèves dans le coin on aurait les aurait fourni, il n’y en a pas eu malheureusement… On a essayé de développer ça la première année en plus de la vente sur place.
Clément : La deuxième année ça a été un peu plus compliqué à cause de la météo. On a un peu plus galéré et puis avec le fonctionnement un peu plus collectif, ça a été plus difficile d’être rigoureux. On a un peu moins produit. La plupart de la production est restée sur la ZAD avec quand même des voisins qui passaient prendre des légumes, on a aussi un peu fourni des cantines mais la production était moins importante que la première année.
Micka : Que ce soit la première comme la deuxième saison, la production était loin de suffire à autonomiser la ZAD en légumes, en termes de quantité. Il y avait aussi des gens qui ne venaient pas et qui faisaient des récups. Si tout le monde était venu, on n’aurait pas pu fournir tout le monde. S’il y avait eu le double voire le triple de légumes, ce serait parti aussi.
Comment se sont passées l’expulsion et la destruction du lieu ?
Clément : Après le premier jour des expulsions on savait que ça allait arriver, on s’était préparés. Il y a eu plusieurs maisons qui ont été expulsées dès le matin. Dès le premier jour, beaucoup de gens se sont rassemblés dans les environs du Sabot, du Far Ouest, des Cent Chênes, etc. C’était encore un lieu qui tenait et où il y avait beaucoup de monde. Il y a eu des moments assez chouettes. Les deux premiers jours il y a eu des affrontements avec les flics. Mais à aucun moment ils n’ont vraiment voulu attaquer, expulser et détruire le Sabot tout de suite. Pendant deux semaines il y a eu des petits affrontements, avec des gens qui restaient. C’était un quartier où il y avait beaucoup de monde du coup. Mais le jour où ils ont voulu expulser il ont réussi à le faire et assez rapidement. C’est un peu un mythe de dire que le Sabot a réussi à résister à l’attaque des flics pendant deux-trois semaines.
Micka : On a résisté moralement. Le fait de venir là, de continuer tous les jours à refaire des barricades sur le chemin, d’amener des provisions pour les gens qui étaient là, de rencontrer des émeutiers, des familles qui venaient le dimanche. Mais militairement c’est sûr qu’on ne pouvait pas contrer une offensive policière mais ce qu’on a fait autour c’était chouette.
Clément : C’était le premier lieu où il y a eu cette résistance-là, ça a peut-être fait changer un peu leurs plans. Ils pensaient que ça allait être facile partout.
Micka : Les premières expulsions sont allées très vite. On a eu l’impression de mettre un grain de sable dans les expulsions
Clément : Au niveau médiatique, ces deux-trois semaines d’attaques avec les gazages, le jardin qui a été piétiné, ça a aussi touché pas mal de monde, ça a ramené des gens de l’extérieur.
Micka : Un des objectifs du Sabot était de faire du lien entre les squatteurs et les paysans et les gens du coin. C’était pas gagné au départ, il y avait quand même un fossé culturel, des pratiques vraiment différentes, deux mondes différents. Les squatteurs étaient plus issus des milieux urbains, militants. Ça a un peu marché, cette démarche de faire des ponts, notamment le 7 mai 2011. Comme ça a été un lieu ouvert collectivement, ça a été important pour sa défense car chaque personne qui avait arraché une ronce le 7 mai avait envie de défendre le lieu. C’était une expérience à réitérer.
Clément : Ça a pris de l’ampleur depuis le 7 mai et là depuis la construction de la Châtaigne le 17 novembre dernier et la manif de réoccupation, c’est un peu la même chose, à 30 ou 40 fois plus. Peut-être que la prochaine fois on sera encore beaucoup plus. C’était la même dynamique : une manif bon enfant avec un chantier qui se fait d’une manière bluffante. Le 17 novembre c’était hallucinant le matos qui était transporté, la vitesse avec laquelle ça se construisait.
Que pensez-vous de la tendance à la disparition des terres cultivables, à Notre-Dame-des-Landes en particulier mais aussi en général ?
Clément : C’est une chose contre laquelle on lutte personnellement, dans nos réseaux, parce que ça va à une vitesse folle. Si on continue comme ça, dans cent ans on n’aura plus un hectare de terres cultivables en France. Les gens ont du mal à concevoir le fait qu’un département de terres agricoles disparaisse tous les six-sept ans. C’est un truc contre lequel il faut lutter directement et c’est pour ça qu’on lutte contre ces projets d’artificialisation des terres, même si ça s’inscrit dans une lutte anticapitaliste globale, c’est aussi pour préserver ces terres. Que ce soit des gros projets comme celui de l’aéroport ou des zones commerciales, même des petites surfaces. Il y a des villes comme Laval où c’est en train de bouffer les terres agricoles à coups de 10-20 hectares. La construction des lotissements bouffe de plus en plus de terres dans les zones rurales, de plus en plus loin des villes. C’est la métropolisation. L’aéroport ajouterait sur une courte période plusieurs années d’artificialisation des terres en comptant aussi les hôtels, des zones commerciales, la ligne LGV Nantes-Rennes. Il y a aussi un impact au niveau de l’eau car le bétonnage réduit les infiltrations d’eau, ça crée des risques d’inondation. Apparemment, avec l’aéroport, Blain risquerait d’être inondé. Sur une zone comme la ZAD, qui est une vraie éponge, les quantités d’eau absorbées sont énormes.
Comment voyez-vous la suite de la lutte contre l’aéroport ?
Micka : Je suis assez confiant, j’ai l’impression qu’il faut qu’on tienne encore quelques mois, qu’on se mette à fond et qu’on va finir par gagner.
Clément : J’étais assez pessimiste, la dynamique sur la ZAD commençait à s’encrouter, à tourner en rond. Les expulsions nous ont donné un bon coup de pied au cul et plein de gens se sont rendus compte de ce qu’il se passait ici. On aurait jamais imaginé la dynamique qu’il y a eu depuis, avec les soutiens, la création de comités un peu partout, le nombre de participants à la manifestation de réoccupation. Il y a de quoi être plutôt optimistes sur la suite. Le projet est aussi en train de se fissurer politiquement.
Micka : Si la préfecture avait attendu quatre ou cinq mois de plus pour expulser, il y aurait peut-être eu moins de monde sur la zone. Ça commençait à s’essouffler un peu avec les occupations et l’hiver qui arrivait. C’est un peu le préfet qui a relancé la dynamique des occupations et de la lutte en général !
Clément : Il y a davantage de gens qu’avant, plus de projets agricoles. Ils ont expulsé le Sabot et là on va se relancer dans des cultures. Il y des projets collectifs un peu partout. En ce moment toutes les deux semaines on fait une AG sur les thématiques agricoles avec les gens qui se sentent investis là-dedans, les paysans du coin… Ça a été un peu difficile car plein de gens sont arrivés avec des cultures différentes. Ça commence à se tasser, on prend des habitudes.
Quel est l’avenir des terres après tout ça ?
Micka : On commence à se poser cette question depuis peu. Il y a de nombreuses possibilités : un autre projet, ou juste le barreau routier sans l’aéroport, un des rêves du maire de Notre-Dame… On lutterait contre ce genre de projet. Il faudra que les paysans sur place continuent à cultiver, qu’il y ait de nouvelles installations. On m’a dit : « Si l’aéroport ne se fait pas, il faudra bien aménager », mais aménager quoi ? Ce sont des terres agricoles ! On ne pourra pas effacer l’histoire du lieu, les occupations des dernières années. Pourquoi pas faire une zone d’autonomie définitive, un peu hors du monde et du temps, vivre comme on le décide.
Clément : Des gens du réseau COPAIN [Collectif des Organisations Professionnelles Agricoles INdignées par le projet d’aéroport, regroupant le réseau Civam 44, la Confédération Paysanne, le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Terroirs 44] réfléchissent là-dessus depuis peu, une structure qui pourrait permettre des installations ou que les gens présents actuellement puissent rester à cultiver les terres sans avoir le statut d’agriculteurs, avoir des projets alternatifs qui ne rentrent pas dans les cases des administrations. Le fait que des paysans installés et des structures et associations agricoles y réfléchissent, c’est très intéressant.
Micka : La seule chose qu’on peut craindre c’est que si l’aéroport ne se fait pas, les squatteurs seront quand même les grands perdants avec le risque de résurgences de conflits internes.
Clément : Les gros paysans du coin se positionnent déjà pour récupérer des terres si le projet ne se fait pas. Que les associations s’y opposent déjà, c’est plutôt positif. En tous cas, ce sera une petite victoire car il y aura encore des luttes à mener.
Micka : Même dans le cas contraire, on aura gagné en vécu, en expérimentations, en liens, en nouvelles pratiques. Tout ça ne sera pas perdu, ça va essaimer.
Pour conclure ?
Micka : Ce qui était classe c’était l’objectif du Sabot, faire du lien entre squatteurs et paysans. Ça a fonctionné, si je devais ne retenir qu’une chose du Sabot, c’est ça. La diversité des pratiques, qu’on puisse tous lutter ensemble, avec des moments forts comme les manifs du 7 mai 2011 et du 17 novembre 2012. La lutte est plus riche comme ça, on ne reste pas dans les carcans identitaires.
Clément : À force de discussions, il y a des gens qu’on commence à voir beaucoup, on se rend compte que des idées changent chez eux, du fait d’être voisins, de faire des choses ensemble.
Publié dans Alimentation, Terre & Environnement
Marqué avec Loire-Atlantique, Nantes, ZAD
Commentaires fermés sur [Terre et liberté] Entretien : l’expérience de ferme autogérée du Sabot (ZAD)
La souffrance, un effet capital
La source des souffrances au travail, c’est avant tout l’organisation capitaliste des entreprises Les suicides de salarié.es de France Télécom interrogent en profondeur le management et l’organisation du travail. Au-delà de la médiatisation, c’est d’abord une question politique.

La souffrance au travail recouvre diverses réalités vécues par les salarié.es du privé comme du public : harcèlement moral, sexuel, pression du chiffre, déshumanisation des relations, troubles physiques, accidents, maladies professionnelles… Des formes qui peuvent se cumuler.
L’analyse de cette notion doit s’élaborer à travers une grille de lecture radicalement critique de l’organisation capitaliste du travail et de l’offensive permanente menée par la bourgeoisie.
L’individualisation et la segmentation des tâches accroissent les contraintes de productivité. L’objectif réellement poursuivi n’est pas seulement la rationalisation de la production et la recherche du profit, mais bien l’intensification du travail, l’individualisation des statuts, la casse des capacités de résistance collective.
Danger, restructurations !
Les politiques de restructuration précarisantes, l’entretien d’un chômage de masse fragilisent les salarié.es. L’individualisation croissante des rapports sociaux et des tâches isolent les salarié.es face au travail, au patron, la souffrance même. Impossible de lui donner du sens, d’en rendre objectives les causes, de l’inscrire dans un combat collectif. Les salarié.es retournent alors la violence subie contre eux-mêmes.
Les conditions de la vie au travail sont à l’entière discrétion du pouvoir patronal. Le « pouvoir de direction », en terme du droit du travail, devient le pendant du droit de propriété privée des moyens de production : la décision revient au possédant. Les droits des salarié.es sont limités, la réglementation du travail se borne à accompagner les effets des restructurations : les salarié.es sont abandonné.es à leur seule capacité à affronter le stress et la pression. La violence des rapports sociaux de classe est ainsi masquée.
L’organisation du travail est un miroir de l’organisation de la société capitaliste : division sociale, technique et sexuelle du travail, rapports de propriété basés sur l’aliénation et la dépossession des travailleurs-euses, subordination juridique, exploitation et domination économique. Les salarié.es sont exclu.es de tout choix organisationnel.
La souffrance vue comme un risque patronal
La législation traite la souffrance au travail sous l’angle de l’obligation qu’a l’employeur d’évaluer tout risque professionnel auquel il expose ses salarié. es et de mettre en place les mesures de prévention permettant, sinon de les supprimer, du moins de les limiter par des protections adaptées.
Tenu à une obligation de sécurité qualifiée d’obligation de résultat, l’employeur doit envisager l’ensemble des facteurs susceptibles de déclencher souffrance mentale et physique au sein de l’entreprise, d’altérer ou de nuire à la santé et la sécurité. C’est dans ce cadre que se placent le droit de retrait ou la notion de danger grave et imminent.
La responsabilité civile ou pénale de l’employeur est de fait engagée. Mais le recours massif à la soustraitance et la faiblesse des pénalités encourues et des condamnations effectives laissent largement impunie la délinquance patronale.
L’enfermement individuel
Si certains cas de souffrance mentale sont légalement reconnus (harcèlement moral, sexuel, discriminations), ils restent strictement limités à la relation individuelle née du contrat de travail. Les salarié.es sont empêché.es de faire reconnaître la violence subie de façon collective et systémique. L’écart entre les faits subis et ceux reconnus par la justice est considérable, car seule est prise en compte la relation individuelle d’un.e salarié.e déterminé.e à un.e supérieur.e hiérarchique.
L’urgence de l’intervention collective des travailleurs et l’action des organisations syndicales, au premier rang pour constater la maltraitance au travail, sont une priorité. Pas question de moraliser l’organisation du travail salarié qui, moins toxique, resterait malgré tout aux mains des détenteurs des moyens de production. Il s’agit de démonter la logique capitaliste.
La nécessité d’une lutte politique impose de s’interroger sur ce que l’on produit, pour qui, dans quelles conditions. Et surtout qui doit détenir le pouvoir dans le travail, les entreprises et la société. S’appuyer sur les expériences de contrôle ouvrier et d’autogestion est un axe politique majeur.
Les leviers juridiques insuffisants et inégalement répartis se heurtent à l’hostilité des organisations patronales.
Un management harcelant ne dépend pas de la taille de l’entreprise. Certains petits patrons déchargent sur leurs salarié.es la pression subie, sans aucun contrepoids syndical à un pouvoir paternaliste.
Le confinement à l’entreprise
La violence ordinaire des rapports sociaux de travail est socialement et tacitement tolérée parce que confinée à l’entreprise. Elle s’exprime aussi entre collègues, sur fond de mise en concurrence entre salarié.es, dans une ambiance de travail dégradée. Elle accroît l’insécurité sociale de travailleurs-euses déjà confrontés à une politique de précarisation généralisée. C’est en cela qu’elle doit être combattue.
Les idéologues du patronat tentent de restaurer la légitimité du management. Mais les seules actions mises en œuvre sont soit des formations en direction des manageurs, soit des actions d’accompagnement individuelles, genre cellule psychologique. Quant au gouvernement, il en appelle à la négociation entre partenaires sociaux, comme si la santé au travail se négociait.
Le mouvement ouvrier doit s’emparer de ces questions, tant à l’échelle de l’entreprise que de la société, pour faire émerger un autre type de rapports. L’enjeu de cette lutte est redonner aux travailleurs-euses une confiance collective pour s’attaquer à l’essence même du pouvoir patronal. Libérer le travail de l’emprise du capital, c’est poser la question de la place du travail dans l’organisation sociale, aujourd’hui basée sur la hiérarchie, l’exploitation et l’oppression.
Gisèle Felhendler (syndiquée fédération Santé Social) – mai 2012
Publié dans General
Commentaires fermés sur La souffrance, un effet capital